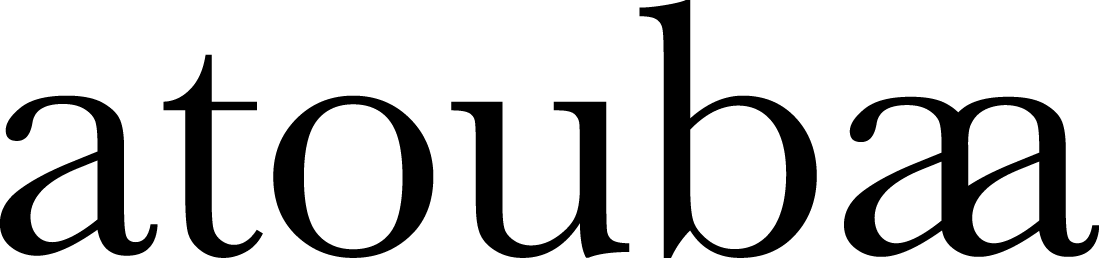Choisir notre libération : entretien avec Rosine Mbakam
Les prières de Delphine (2021) réalisé par Rosine Mbakam.
La dernière scène de Les Prières de Delphine montre Delphine coiffant Rosine. Les deux femmes partagent l’un de ces nombreux moments privilégiés qui ont posé les bases de leur amitié. La voix de Rosine habille la scène, et fait son propre mea-culpa : le film existe parce qu’elle a enfin pu voir Delphine dans toute son entièreté, passant au-delà des idées préconçues qu’elle a longtemps associées aux femmes au parcours similaire. Pour la cinéaste camerounaise, c’est également une manière de clarifier son propos politique : il y est aussi question de ce joug patriarcal et colonial qui conditionne les vies des femmes de ses films. Il planait déjà au dessus de sa mère dans Les deux visages d’une femme Bamiléké et au dessus de Sabine dans Chez Jolie Coiffure.
Diffusé en avant-première lors de la 43ème édition du festival international du film documentaire Cinéma du Réel, Les prières de Delphine de Rosine Mfetgo Mbakam a remporté le prix du jury des jeunes. A l’occasion de cette première diffusion mondiale, je me suis entretenue avec la réalisatrice pour discuter des liens entre ses trois premiers films et de sa quête d’un cinéma de libération.
Les Prières de Delphine a été filmé entre 2014 et 2015. C’est le premier film documentaire sur lequel vous avez travaillé, mais il ne sera que le troisième dans votre filmographie. Pourquoi le sortir aujourd’hui ?
Au moment où je l’ai tourné, je pense que je n’avais pas la maturité nécessaire pour aborder cette matière, pour aborder toute la complexité de l’histoire de Delphine, et le faire de manière juste. J’avais fait une première version du montage, et j’avais alors réalisé que je m’étais un peu approprié son histoire. Le film racontait ma colère du moment. À ce moment là, je faisais une école de cinéma en Belgique où j’étais la seule noire et je vivais un peu de discrimination. J’étais en colère, et j’avais ce témoignage de Delphine qui était également traversée par cette discrimination, ce patriarcat. J’exprimais ma colère à travers son histoire, et je ne lui laissais pas la possibilité de se raconter simplement dans sa singularité.
En revoyant le film, je me suis dit que ce n’était pas du tout le cinéma que j’avais envie de faire. J’ai donc pris le temps et j’ai fait Les Deux Visages d’une femme bamiléké puis Chez Jolie Coiffure. Cela m’a permis non seulement d’exprimer des choses que j’avais envie d’exprimer à l’époque, mais aussi de prendre de la distance par rapport à ce que j’avais vécu à l’école, par rapport à l’histoire de Delphine, et d’y arriver de manière plus apaisée.
Vos films sont très intimes. Les femmes que vous documentez, vous les connaissez : votre mère et ses sœurs, Sabine votre coiffeuse, et Delphine que vous connaissez également depuis votre arrivée en Belgique. Est-ce qu’on peut dire que vos films sont aussi une manière de retracer en filigrane votre propre trajectoire ?
L’envie d’un film vient de quelque chose de personnel, c'est-à-dire un questionnement, ou un sentiment que j’ai envie d’interroger, auquel je veux me confronter. Par exemple, dans Les Deux Visages, je voulais retourner [au Cameroun], juste savoir si après mon départ et tout ce que j’avais appris en Belgique j’arriverais à retrouver ma place. Selon un adage bamiléké, « il est compliqué de poser certaines questions à ses parents », et je voulais justement confronter cette barrière du respect et parler à ma mère en tant que femme. Partir m’avait permis de devenir maman et femme, comme elle, et je trouvais que j’avais maintenant la legitimité de lui poser certaines questions. Donc cela part toujours d’un sentiment ou d’une envie de me confronter à quelque chose de personnel. Le but n’est pas de faire un film sur moi, mais de partir de questionnements et de sentiments personnels que je confronte avec des personnes précises, qui vont peut-être m’aider à mieux comprendre ce que je ressens, ce que je cherche à confronter, voire me fournir des réponses.
Pareil avec Chez Jolie Coiffure, que j’ai tourné dans une galerie en Belgique proche de mon école de cinéma en Belgique. À chaque fois que je traversais cette galerie, je me sentais très mal à l'aise. Et je me disais alors : « Mais ces filles viennent pour certaines du même quartier populaire que moi, pourquoi je me sens mal à l’aise ? Je devrais me sentir bien là, mais pourquoi je me sens mal à l’aise ? » Et je me suis rendue compte en filmant dans ce salon de coiffure que je me positionnais du mauvais côté. Je les regardais comme le font les touristes, et j’avais ce sentiment de mal-être et de malaise parce que je n’avais pas ma place dans la galerie. Quand j’ai commencé à filmer dans le salon, et que je n’ai plus eu ce sentiment là, j’ai compris pourquoi.
C’est la même chose avec Delphine. Elle me permet d’exprimer une culpabilité. Parce que bien qu’ayant grandi dans les mêmes quartiers populaires qu’elle [au Cameroun], j’étais entourée par ma famille, par mes parents, qui veillaient sur moi. Ils me disaient justement : « si tu veux t’en sortir, ne fréquente pas ce genre de filles ». J’ai grandi avec cette idée : en les mettant à distance parce que je ne connaissais pas toute leur histoire. Je voyais juste ce qui était apparent et je les jugeais. Delphine m’a donné accès à son histoire, elle m’a permis de réaliser que je ne pouvais pas réduire les gens à un élément. Une personne ne se résume pas à un acte, à un seul élément, c’est une multitude de choses. Et c’est ce que je montre dans le film avec Delphine. J’y exprime aussi ma culpabilité, parce que j’ai enfermé Delphine dans des stéréotypes qui viennent de la manière dont on m’a appris à la regarder. C’est pourquoi j’ai dû construire ma propre relation avec Delphine : une amitié comme je voulais, en laissant tomber tous ces stéréotypes et cette cécité.
J’aimerais qu’on parle des lieux où vous filmer vos documentaires. Le premier est filmé entièrement au Cameroun, le deuxième en Belgique, le troisième aussi, sauf que les récits de Delphine nous font osciller entre les deux pays tout en les liant. C’est une femme qui a été victime de la société patriarcale camerounaise et qui pensait pouvoir y échapper en « partant », mais se retrouve face à des réalités similaires en Belgique. C’est important pour vous de briser cette idée qu’il existe cet « ailleurs » occidental qui serait foncièrement meilleur que celui du « pays » ?
Pour moi, toutes ces idées et tous ces schémas de pensée nous viennent de la colonisation. La manière dont on voit l’Europe, c’est la manière dont les stratégies coloniales veulent qu’on regarde l’Europe : comme étant l’endroit où on va s’épanouir, l’endroit où tout est bien, l’endroit où on s’en sort. La domination tient aussi de cette fascination là. Donc cet ailleurs fonctionne bien dans cette stratégie coloniale, parce qu’on estime alors que notre libération viendra de là-bas.
Delphine a pensé que la libération viendrait de là-bas, tout comme je le pensais quand je suis allée étudier en Belgique. J’estimais que j’apprendrai mieux à raconter des histoires en allant faire une école européenne, comme beaucoup de gens. On pense qu’en allant faire une école européenne on aura plus de crédit, plus de reconnaissance, alors que c’est loin d’être vrai. C’est une construction. C’est parce qu’il y a quelque chose en nous, ce complexe, qu’on regarde toujours vers cet ailleurs. Et justement, dans la construction du film, je reviens toujours à ce sujet. J’essaye de dire que la libération dépend de nous, tout comme la déconstruction de ces idées. Mon cinéma est basé là-dessus : c’est un cinéma de libération.
C’est par exemple ma mère qui vend dans un marché à Yaoundé et qui parle politique, alors qu’elle n’en serait pas capable selon les représentations habituelles des femmes africaines comme elle. Mais elle parle politique avec ses termes, et c’est une manière de se décoloniser. Delphine aussi le dit dans le film, elle dit : « je n’ai peut-être pas lu tous les livres des bibliothèques, je n’ai peut-être pas fait ci ou ça, mais j’ai une intelligence, une intelligence humaine que personne ne peut m’enlever. Une intelligence humaine qu’on ne trouvera pas dans ces livres ». Donc pour moi cet ailleurs là, je le déconstruis en disant qu’il n’est rien. Delphine le dit aussi. Elle met à nu cet « eldorado ».
J’aimerais aussi que vous me parliez du choix de la filmer dans une seule pièce, qui prend d’ailleurs la forme d’une autre prison à mesure qu’on l’entend parler. Chez Jolie Coiffure se déroule aussi dans le même lieu (le salon de Sabine).
On parle de confinement aujourd’hui, mais il y a une partie de la population qui vit en confinement tout le temps. Il y a les immigrés qui vivent confinés, il y a les sans-papiers qui vivent confinés, dans des espaces et des lieux justement bien choisis pour ne pas s’exposer.
Sabine, son salon de coiffure, c'est le seul espace où elle peut s’exprimer librement. En dehors de ce salon, elle est en représentation. Pareil pour Delphine : son lit, sa chambre, c’est le seul espace où elle peut dire voilà ce que je suis, parce quand elle sort elle se retrouve face à ce que la société veut qu’elle soit. Sabine, quand elle sort de son salon, elle prétend être libre alors qu’elle est sans-papiers : elle est en représentation.
Dans Les Deux Visages, je filme les paysages, plein de choses… je voulais montrer des êtres qui évoluent dans des espaces de liberté, mais qui, en Europe, restent enfermés dans des espaces très réduits et qu’on réduit à ces lieux. On dit « aller dans le quartier africain » comme si ce n’était que là qu’on pouvait rencontrer des Africains, par exemple. Le huis clos que je montre est donc effectivement une sorte de prison, parce qu’on les réduit à ces espaces et c’est comme si elles ne pouvaient pas être autre chose.
… et au final, ces espaces prennent une autre dimension quand on les entend, quand on les regarde. Et quand elles parlent, on voit toute la multidimensionnalité qui peut exister même dans ces espaces restreints.
Tout à fait.
Il y a cette scène du miroir qui revient souvent dans vos films. Dans Les Deux Visages, on voit votre mère devant son miroir. Sabine aussi passe du temps devant le sien, et Delphine également. J’aimerais faire un parallèle avec ce que vous avez dit plus tôt sur la capacité de ces femmes à comprendre et à décrire leur condition avec leurs propres mots. Vous ne parlez jamais pour elles. En tant que réalisatrice africaine et qui se décrit comme telle, cette scène vous semble importante voire indispensable ?
Oui. C’est une manière de dire que ma représentation m’appartient et que personne ne peut la définir. Ce que je suis, ce que je représente, seule moi peut le définir, personne ne peut me définir mieux que moi-même. Quand ma mère s’apprête devant son miroir, la femme qu’elle est, elle seule peut me la donner. Moi-même, en tant que réalisatrice, je ne peux pas la saisir.
C’est aussi une manière différente de raconter des histoires, car ce qu’on nous apprend en école de cinéma, c’est de savoir ce qu’on a envie de raconter, d’être certain… Sauf qu’on n’est pas toujours certain de ce qu’on a envie de raconter. Mais en tant que réalisatrice, on doit garder le pouvoir et faire comme si on savait. Dans ces moments-là, je me dis que ce que j’arrive à saisir et à raconter de ces trois femmes, c’est ce qu’elles veulent bien me donner. Je ne peux pas y avoir accès, le spectateur ne peut pas y avoir accès si elles ne nous donnent rien.
Pour moi, c’est aussi une manière de me dire que le cinéma que je fais m’appartient. La responsabilité du cinéma que j’ai envie de faire m’appartient et c’est à moi d’aller trouver les moyens de faire ce cinéma là. Et c’est à chacune d'entre nous d’aller chercher comment on veut se représenter, comment on veut s’affirmer.
De toutes les femmes que vous avez filmées, Delphine est une des plus expressives. C’est celle qui dit vouloir que son histoire soit connue, et c’est aussi celle qui arrive à l’implosion, du moins l’implosion filmée . Quelle importance à cette scène — peut-être en relation à vos deux premiers films ?
Ce moment arrive là, parce que je ne pense pas que ces films-là soient un hasard. Parce que cela permet de dire que l’implosion qu’on a l’habitude de voir dans les films d’européens qui filment l’Afrique, c’est une implosion qui demande de l’aide, et là ce n’est pas le cas. Delphine se purifie. Cette séquence est une sorte de purification dont elle n’en sort pas en se disant « mon secours viendra de telle institution », elle se dit « mon secours viendra de moi ».
Pour moi, c’est très parlant, parce que je suis venue ici en me disant naïvement — colonisée comme j’étais — que j’allais apprendre à raconter des histoires ici. Et elle me dit aussi à moi que mon cinéma ne viendra pas de quelqu’un, qu’il viendra de moi et d’où je viens, c’est-à-dire le Cameroun et pas ailleurs. Pour moi c’est une séquence très importante, parce qu’en tant que camerounaise ou africaine, cela devrait nous ramener à ce qui est essentiel pour nous. Devons-nous à chaque fois nous définir à travers l’Europe ou bien nous définir à travers ce qui nous constitue ?